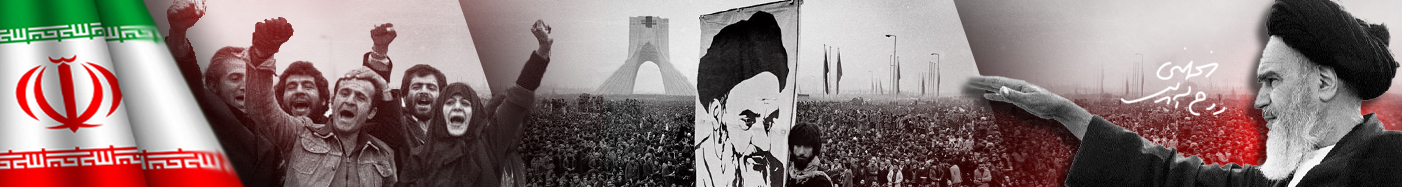Liban: Le Premier ministre met le pays à découvert devant les périls: Une stratégie… sans défense

Par Ali Haidar*
Le débat sur la stratégie de défense et la sécurité nationale au Liban est l'un des sujets politiques les plus sensibles, car il croise le concept de souveraineté avec les outils de protection et de dissuasion, tout en étant lié à la structure du système politique et aux alignements régionaux et internationaux. La relation entre la «stratégie de défense» et la «stratégie de sécurité nationale» n'est pas simplement un lien procédural ou une agrégation mécanique de deux dossiers séparés, mais elle est fondamentalement constitutive : la première forme la base structurelle solide, tandis que la seconde incarne le cadre global sur lequel elle se construit.
Cette relation va au-delà des limites de l'organisation administrative pour révéler la philosophie de l'État face aux risques et aux menaces, mettant en lumière la dimension politique et intellectuelle de ses choix en matière de sécurité. Ainsi, comprendre cette dialectique éclaire les fondements structurels des forces politiques et leurs conceptions du rôle du Liban dans son environnement régional et de sa position dans l'équilibre des puissances.
L’annonce du Premier ministre Nawaf Salam selon laquelle il ne présente pas une «stratégie de défense» mais une «stratégie de sécurité nationale» coïncide avec l'agression «israélienne» contre la direction du mouvement Hamas à Doha, ce qui porte des significations symboliques, politiques et sécuritaires, notamment que cela a pratiquement démoli l'hypothèse longtemps promue selon laquelle «le giron américain» constitue une protection contre les agressions «israéliennes». Cet événement revêt une importance en tant que preuve vivante de l'échec du pari sur l'abri américain plutôt que sur la résistance ou la construction d’une capacité de défense autonome. La sécurité nationale ne se préserve pas par des promesses, mais par des capacités réelles, et ce concept se manifeste plus clairement lorsque l'État est petit et fragile.
Lorsque le Premier ministre déclare que ce qui est proposé n'est pas une «stratégie de défense» mais une «stratégie de sécurité nationale», le débat s'ouvre sur la séquence logique de l'élaboration des stratégies. La «sécurité nationale», au sens large, commence par l'identification des risques et des menaces, puis par la formulation des politiques et des outils nécessaires pour y faire face. Selon cette logique, la stratégie de défense devient une conséquence inévitable et le couronnement du parcours de la sécurité nationale. Par conséquent, l'absence d'une politique de défense précise transforme le document de sécurité nationale en un cadre administratif interne, incapable de répondre à la question fondamentale : comment prévenir et repousser l'agression ? Ainsi, un paradoxe pratique émerge : annoncer de grands objectifs sans outils de protection, c'est-à-dire des objectifs sur le papier sans bases concrètes.
Alternatives théoriques
Il semble que le Premier ministre soit pleinement conscient du poids de chaque mot qu'il prononce, ce qui signifie qu'il adopte, de manière consciente, des alternatives spécifiques au lieu de formuler une stratégie de défense pour le Liban. Ces alternatives se répartissent en trois grandes voies : laisser le Liban sans protection dissuasive ou défense autonome ; supposer que l'armée libanaise peut seule accomplir cette tâche ; et compter sur les institutions internationales ou sur l'abri américain pour protéger le Liban.
Cependant, l'expérience libanaise et arabe, ainsi que les leçons de l'histoire récente, montrent que ces trois alternatives ne sont pas réalisables dans la pratique. Le Liban, de l'occupation «israélienne» aux agressions terroristes, en passant par les défis régionaux récurrents, fait face à un environnement changeant qui menace périodiquement son existence. Le «désarmement» de ses capacités défensives signifie, en pratique, le transformer en un terrain conquis sans force de défense.
Le passage de la question «comment défendre ?» à «qui détient la décision ?» ne résout pas la crise, mais la redéploie.
Concernant le pari sur l'armée seule pour assumer la mission de défense, il suffit de considérer l'énorme écart technologique et destructeur entre les capacités de l'ennemi et la réalité de l'armée libanaise. Même en laissant de côté les détails financiers et logistiques, il est essentiel de reconnaître que l'armée opère dans un environnement complexe, tant interne qu'externe, avec des points faibles structurels, géographiques et démographiques qui rendent la mission presque impossible. En principe, chaque État souverain doit compter sur son armée nationale pour se défendre, mais la spécificité du Liban, en termes de taille, de système, d'équilibres et de position dans un conflit ouvert, rend ce pari semblable à une aventure imprudente pour l'institution militaire.
Quant à la mise en avant de la légitimité internationale ou de l'abri américain, cela est devenu sujet à dérision après des décennies d'expérience arabe avec «Israël» et le soutien illimité dont bénéficie «Tel-Aviv» dans ses politiques expansionnistes et agressives. Les priorités américaines dans la région restent centrées sur ses propres intérêts de sécurité et stratégiques, plutôt que sur la protection du Liban ou d'autres. Toute conjoncture politique internationale est changeante, susceptible de se retourner en fonction des intérêts changeants, rendant impossible la construction d'une sécurité nationale sur cette base.
Contexte politique interne
À la lumière des risques évidents et des capacités limitées, il est légitime de se demander quelles sont les motivations qui poussent certaines forces politiques à rejeter toute stratégie de défense reposant sur les éléments de force libanais, notamment la Résistance. Ces motivations ne sont pas homogènes. Certaines de ces forces se cachent derrière des slogans tels que «rétablir la souveraineté de l'État » et « monopoliser les armes», ignorant que le critère de patriotisme et de souveraineté est l'effort et les capacités réelles déployés pour protéger la patrie. D'autres ne considèrent pas «Israël» comme une menace existentielle et voient leur intérêt dans une alliance avec lui ou misent sur ses options. Certaines sont également liées à des connexions régionales ou américaines, ou appliquent directement des agendas extérieurs. D'autres encore répètent ces discours sous l'influence de campagnes médiatiques et politiques, sans une compréhension complète des dimensions stratégiques de la sécurité nationale.
Quoi qu'il en soit, les positions du Premier ministre contribuent à intensifier la division politique libanaise et sont interprétées comme un soutien à des agendas extérieurs au détriment des éléments de force internes du Liban, presque comme une incarnation pratique des exigences de l'ennemi israélien et de la politique américaine, qui cherche à dépouiller la région de ses éléments de défense et de puissance.
Ce passage du débat de la question «comment défendre?» à «qui détient la décision ?» ne résout pas la crise, mais la redéploie. Si l'on souhaite que la stratégie de sécurité nationale soit sérieuse, elle doit reposer sur une politique de défense clairement définie (incluant la doctrine militaire, les capacités, le financement, les délais et la répartition des rôles), sinon elle se transforme en un simple titre administratif qui ne protège pas le pays ni ne consolide sa souveraineté. De plus, le rejet de l'exploitation de la force que représente la Résistance oblige le gouvernement à clarifier sa position : soit choisir une politique de défense qui prenne en compte les capacités du Liban et ses conditions internes et régionales, soit reconnaître explicitement les dangers d'un vide dissuasif et les coûts qui en découlent, tant internes qu'externes.
Un pays sans une stratégie de défense clairement définie, avec des moyens et des éléments de force explicites, ne peut être qu'un discours creux. Le danger de ce vide se renforce lorsqu'il coïncide avec des moments de grand test, comme c'est le cas au Liban aujourd'hui, face à l'agression «israélienne» dans la région et sous la pression internationale pour redessiner les cartes d'influence et de sécurité. Ainsi, la redéfinition de la sécurité nationale ne peut se faire sans prendre en compte sa dimension défensive et dissuasive, mais nécessite une décision politique audacieuse qui concilie les impératifs de souveraineté avec les exigences de protection. Ne pas agir en ce sens ouvre la porte à l'effondrement des équilibres dissuasifs et rend le Liban prisonnier des tempêtes extérieures qui caractérisent la région. La leçon la plus marquante de l'histoire du Liban et de la région est que la «véritable souveraineté» se mesure par la capacité à protéger, et non par des discours.
*Article paru dans le quotidien libanais al-Akhbar, traduit par l'équipe du site
Comments