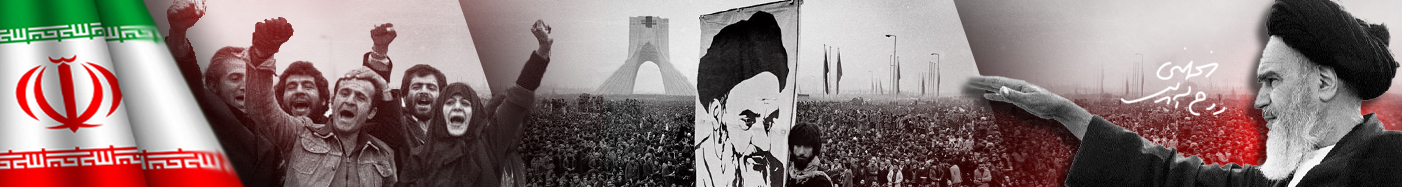Pourquoi les armes du Hezbollah demeurent «légitimes» selon le Droit International ?

Par AlAhed
Malgré la soumission de Beyrouth aux pressions américaines, les conventions de Genève confirment le droit à la résistance contre l'occupation «israélienne», comme l’a prouvé le cours de l'histoire.
Le Droit à la Résistance contre l'occupation
Lorsque la terre est envahie et que la dignité est sapée par une armée étrangère, il n'existe pas de droit plus sacré et urgent que celui de résister. Ce droit n’est pas limité par la politique, et ne peut être annulé par des gouvernements complices ou des impositions extérieures, et n’est pas affecté par des classifications biaisées telles que «terroriste» ou «illégal».
L'histoire regorge d’exemples où des mouvements de libération se sont opposés à l'occupant, n'hésitant pas à défier leurs propres gouvernements dominés.
La récente décision du gouvernement libanais, prise sous pression extérieure, de désarmer le Hezbollah, est un exemple amer d'une réalité qui se renouvelle. Elle illustre un paradoxe choquant : une armée étrangère renforce son occupation sur votre terre, envahit votre maison, s'approprie vos terres et arrête vos fils ; et pourtant, le gouvernement qui prétend vous représenter, tout en étant manipulé par des capitales lointaines, déclare que se défendre est un crime.
Les armes dirigées contre l'occupant sont désormais classées comme «illégales». Quelle justice est-ce là ? C'est une scène grotesque dans la pièce de théâtre de l'occupation, où une autorité sous contrôle étranger criminalise la lutte pour la liberté.
Ce schéma préoccupant s'est répété maintes fois au cours de l'histoire. Lorsque les chars nazis ont envahi l'Europe, le régime de Vichy en France, qui n'avait aucune légitimité, qualifiait les résistants du mouvement «maquis» d'illégaux et de terroristes. Cependant, le temps a rendu justice aux «maquisards», et leur lutte a été reconnue comme l'expression pure de la volonté d'une nation qui refusait de disparaître et insistait pour survivre.
De même, les administrations coloniales et leurs complices locaux ont condamné les mouvements de libération, tels que le «Viet Minh» au Vietnam et le «Front de Libération Nationale» en Algérie, en les qualifiant de terroristes. Pourtant, le droit international, tout comme le cours de l'histoire, a reconnu la justesse de leur cause, considérée comme l'incarnation d'un droit inaliénable à l'autodétermination et à la résistance contre la domination étrangère.
Il n'y a pas si longtemps, Nelson Mandela a passé des décennies dans la prison de l'île Robben, après avoir été classé comme un terroriste par le régime d'apartheid et les gouvernements qui le soutenaient. Son organisation, le «Congrès National Africain», était interdite, et son seul crime était de revendiquer le droit fondamental de son peuple à vivre librement sur sa terre. Aujourd'hui, Mandela est devenu un symbole mondial de la résistance juste.
Le schéma est clair : lorsque des gouvernements affaiblis par des pressions étrangères criminalisent l'acte de résistance, ils n'annulent pas le droit, mais exposent leur propre illégitimité. C'est une vérité reconnue par le droit international.
Accords de Genève et Droit à la Résistance protégé
Le droit international humanitaire protège les droits des peuples qui subissent l'occupation. L'article 47 de la quatrième Convention de Genève stipule qu'il est interdit de priver les populations sous occupation de leurs droits «en vertu de tout accord» conclu entre l'occupant et les autorités locales. Aucun gouvernement collaborant avec l'occupant ne peut légalement criminaliser la résistance.
Le Protocole additionnel premier, article 1 "4", reconnaît que la lutte armée contre «la domination coloniale, l'occupation étrangère et les régimes racistes» constitue un conflit international légitime, et non une rébellion criminelle. L'Assemblée générale des Nations Unies a confirmé ce principe dans sa résolution 3314 de 1974, affirmant le droit des peuples soumis à la domination étrangère à résister «par tous les moyens disponibles, y compris la lutte armée».
De plus, les accords de Genève établissent une ligne claire : le droit à la résistance contre l'occupation étrangère est un droit inaliénable. Les gouvernements agissant sous l'influence de l'occupant perdent leur légitimité morale pour définir ce qui est «légitime». De la résistance des «maquisards» en France à Nelson Mandela en Afrique du Sud, l'histoire a toujours prouvé la justesse des mouvements de résistance, même lorsqu'ils étaient condamnés par leurs propres gouvernements.
Rôle du Hezbollah et son statut légal
Le Hezbollah est né en réponse à l'invasion «israélienne» et à l'occupation du sud du Liban en 1982, se posant comme le seul défenseur d'un peuple abandonné par les forces armées libanaises. Il est largement reconnu par les observateurs internationaux que le conflit entre le Hezbollah et «Israël» est un conflit armé international qui relève de la protection des accords de Genève.
De plus, l'article 9 des articles sur la responsabilité des États, publiés par la Commission de droit international, permet de reconnaître les groupes armés qui jouent le rôle des autorités officielles en leur absence ; un rôle que joue le Hezbollah dans le sud du Liban sous occupation.
Protection constitutionnelle: Accord de Taëf
La législation libanaise renforce cette légitimité ; l'accord de Taëf, intégré dans la Constitution, stipule que toutes les «mesures nécessaires doivent être prises pour libérer tous les territoires libanais de l'occupation israélienne». Pendant des décennies, ce texte a été interprété comme légitimant la résistance armée jusqu'à la libération complète des territoires occupés.
Modifier cette interprétation nécessiterait un amendement constitutionnel selon l'article 79, qui exige une majorité des deux tiers des membres du parlement. Aucun acte de ce type n'a été enregistré, ce qui rend la décision unilatérale du gouvernement de désarmer le Hezbollah une violation explicite du système constitutionnel libanais.
Droit, histoire et autorité morale
La question n'est pas de savoir si la décision de Beyrouth satisfait Washington ou les bailleurs de fonds internationaux, mais la véritable question est : un quelconque gouvernement, sous pression extérieure alors que des parties de son territoire restent occupées, a-t-il le droit d'interdire la défense de sa terre ? Le droit international répond clairement: non.
Des champs de bataille en France occupée aux cellules du régime d'apartheid en Afrique du Sud, le cours de l'histoire tend à innocenter ceux qui résistent à l'occupation. La déclaration de Beyrouth contre l'arsenal du Hezbollah — émise à un moment où «Israël» occupe encore des terres libanaises et menace de nouvelles incursions — ne peut effacer les droits garantis par les accords de Genève.
La flamme de la résistance, une fois allumée par l'occupation, ne s'éteint pas simplement parce qu'un gouvernement a décidé ainsi — surtout lorsque ce gouvernement parle avec un accent étranger.