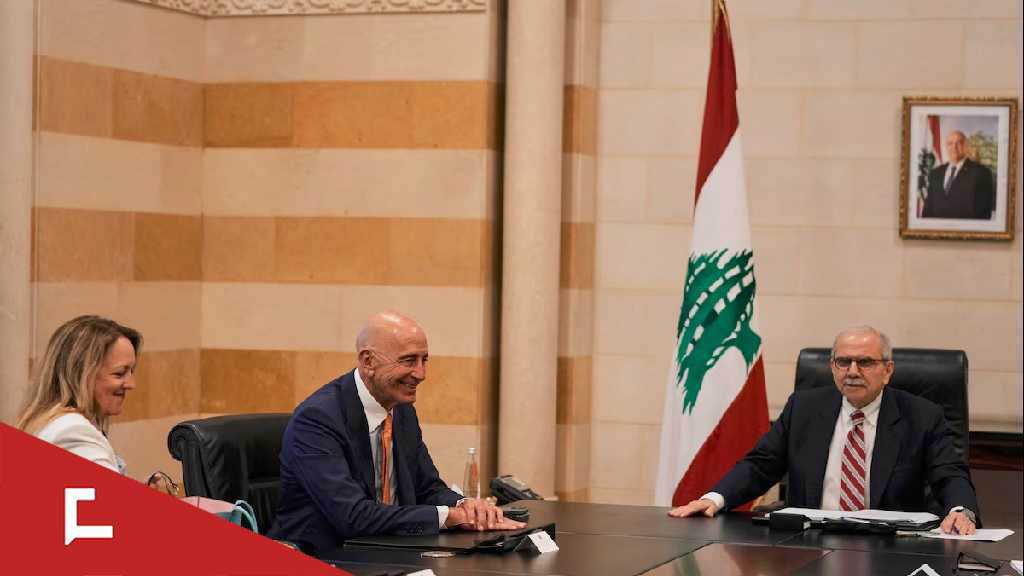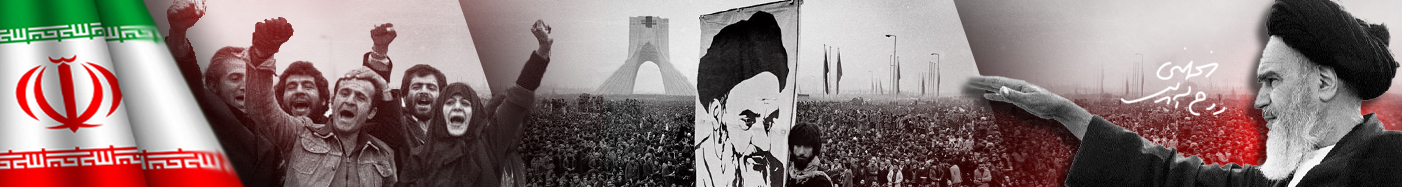Une dynamique diplomatique inédite en faveur de l’Etat de Palestine mais non du peuple palestinien

Par Assia Husseini
La scène diplomatique internationale a connu, au cours de la dernière semaine, une série d'annonces sans précédent et à un rythme accéléré, de la part d'États occidentaux influents, exprimant leur intention de reconnaître l’État de Palestine. Ainsi, à l’initiative conjointe de la France et de l’Arabie saoudite, la «Conférence internationale pour le règlement pacifique de la question de Palestine et la mise en œuvre de la solution à deux États» s’est tenue à New York, avec la participation de plus de 125 pays.
Un appel conjoint a été signé par les ministres des Affaires étrangères de 15 pays occidentaux, encourageant la reconnaissance de l’État de Palestine. Il s’agit de : l’Andorre, l’Australie, le Canada, la Finlande, la France, l’Islande, l’Irlande, le Luxembourg, Malte, la Nouvelle Zélande, la Norvège, le Portugal, Saint Marin, la Slovénie et l’Espagne. Parmi eux, certains pays ont déjà reconnu l’État palestinien, d'autres ont exprimé leur intention de le faire, et d'autres encore ont déclaré vouloir examiner positivement cette possibilité.
L’État de Palestine est déjà reconnu par 147 pays membres des Nations unies (sur un total de 193), mais cette reconnaissance reste partielle et ne constitue pas une adhésion pleine à l’ONU, faute d’un vote favorable au Conseil de sécurité ou d’un consensus élargi à l’Assemblée générale.
Au-delà des 15 pays précités, un ensemble plus large de gouvernements et d’organisations — comprenant environ 16 États, l’Union européenne et la Ligue arabe — ont approuvé la Déclaration de New York issue de la conférence. Il s’agit notamment de : la France, le Royaume Uni, le Canada, le Brésil, l’Égypte, l’Indonésie, l’Irlande, l’Italie, le Japon, la Jordanie, le Mexique, la Norvège, le Qatar, le Sénégal, l’Espagne, la Turquie, ainsi que l’Union européenne et la Ligue arabe. Ces pays se sont engagés à soutenir la solution à deux États, un cessez le feu immédiat et la reconstruction de Gaza.
Le rôle ambivalent de l’Arabie saoudite et les critiques du Hamas
Néanmoins, alors que les pays arabes et islamiques sont restés passifs face aux massacres et à la guerre d’extermination et de famine à Gaza, cette initiative apparaît comme une tentative de réhabilitation de la part de l’Arabie saoudite — principal initiateur de la conférence — souvent perçue comme le «leader du monde islamique». Un pays qui, par ailleurs, considère toujours les mouvements de résistance dans la région comme des organisations terroristes, et détient encore aujourd’hui des responsables du Hamas dans ses prisons. Depuis le début de l’agression « israélienne» contre Gaza, Riyad mène une politique médiatique hostile à l’axe de la résistance, notamment à travers ses chaînes, dont Al Arabiya, allant parfois jusqu’à exprimer un soutien indirect à «Israël».
C’est dans ce contexte que la conférence a été perçue comme une tentative d’exclure les mouvements de résistance, en particulier le Hamas, en l’appelant à déposer les armes, libérer les captifs et mettre fin à sa gouvernance dans la bande de Gaza.
Tayssir Suleimane, responsable du Hamas en exil, s’est exprimé à ce sujet dans une déclaration à Al-Ahed : «Où étaient les Arabes pendant les 22 derniers mois ? Pourquoi n’ont-ils pas élevé la voix pour arrêter les massacres ? La guerre n’a pas commencé le 7 octobre, mais en 1948», a-t-il déclaré, affirmant le droit du peuple palestinien à la résistance, et rejetant catégoriquement toute initiative exigeant la reddition des armes.
Une initiative qui ne diffère pas de celle de 2002 et demandant plus de concessions palestiniennes
Suleimane a rappelé qu’en 2002, lors du lancement de l’Initiative arabe, il n’y avait ni résistance armée, ni tunnels, ni combattants. Pourtant, Ariel Sharon a assiégé le président de l’Autorité Palestinienne Yasser Arafat, bombardé la Mouqataa, détruit l’aéroport, construit le mur, emprisonné des milliers de Palestiniens et assassiné des intellectuels. Il a souligné que les initiatives et les conférences actuelles ne reflètent pas une posture de force arabe ou islamique, mais plutôt une adaptation aux positions occidentales. «Pourquoi le camp palestinien est-il toujours celui sur lequel on fait pression pour qu’il renonce à ses droits, fasse des concessions, afin que l’occupation l’accepte, ou que l’ordre occidental — israélo-européen ou américain — lui accorde un semblant de reconnaissance ?», s’est-il interrogé.
Et d’ajouter : «Toute initiative qui ne reconnaît pas les droits du peuple palestinien ne m’engage en rien — ni en tant que Palestinien, ni en tant que membre de la résistance, ni en tant que représentant du Hamas. Je ne suis pas tenu de l’accepter sous prétexte que je suis faible, ou que le contexte arabe est défavorable, ou que l’Occident est partial. J’affirme mes principes, même si je dois en payer le prix — car l’Histoire enseigne que la libération de la terre exige des sacrifices.»
Une conférence sans effet face au refus «israélien» d’un État palestinien
De son côté, l’expert palestinien Tayssir Al-Khatib a qualifié la conférence de «simple opération de relations publiques», ajoutant : «Cette reconnaissance de l’État palestinien fait l’impasse sur de nombreuses réalités : elle évite de désigner les responsables de la catastrophe actuelle à Gaza, et elle place sur un pied d’égalité les deux parties — israélienne et palestinienne — une logique habituelle chez les Européens et les Américains.»
Selon lui, cette approche n’a aujourd’hui aucune portée face à la politique américaine, marquée par des renoncements successifs depuis l’époque de Clinton jusqu’à Obama, et même Biden : «Cette conférence aurait dû clarifier de quel État il s’agit. Est-ce celui des accords d’Oslo, piétinés par Israël ? Et pourquoi la colonisation, principal obstacle à la création d’un État palestinien, n’a-t-elle pas été abordée ?», s’interroge Al-Khatib. Il affirme que le «véritable objectif de la conférence est de donner l’impression que ces pays agissent face à l’horreur de Gaza, alors qu’elle ne diffère en rien de l’Initiative de paix arabe — rejetée par Israël — ni des accords d’Oslo.»
En effet, le «gouvernement» de Benjamin Netanyahu, soutenu par une coalition ultra-nationaliste, reste catégorique : la création d’un État palestinien souverain est incompatible avec la «sécurité d’Israël», et sera combattue par tous les moyens juridiques et politiques. Le seul compromis envisagé demeure une autonomie sans souveraineté sécuritaire, sous stricte tutelle «israélienne». Et le 7 juillet dernier, lors de sa visite à la Maison Blanche, le «Premier ministre israélien» a décrit tout futur État indépendant comme «une plateforme destinée à détruire Israël».
Comments