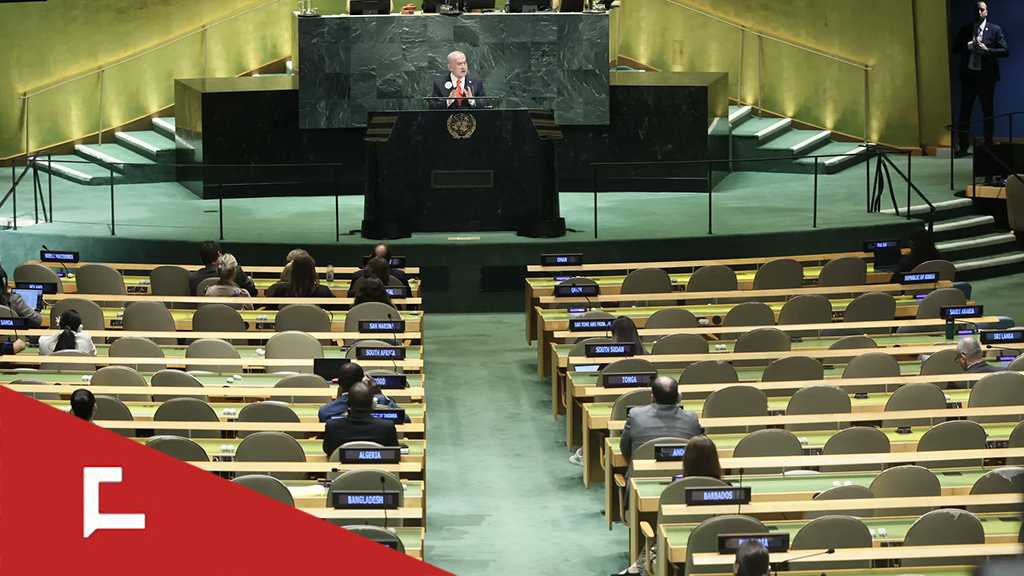Gaza: Un accord fragile entre guerre, pressions et calculs politiques

Par Assia Husseini
«Israël» et le mouvement de résistance Hamas ont conclu ce qui est présenté comme la «première phase» d’un accord plus large visant à mettre fin à la guerre dévastatrice sur Gaza. Mais derrière l’annonce, les contours demeurent flous et l’équilibre fragile.
Loin des effets de mise en scène, des discours triomphants et des calculs politiques à Washington comme à «Tel-Aviv», l’accord ne semble, pour l’heure, qu’un échange limité : des captifs «israéliens» contre des prisonniers palestiniens, un allègement partiel du blocus et la promesse encore incertaine de futures négociations.
Autant d’éléments qui traduisent moins la fin du conflit que la difficulté à en définir une issue réelle et durable.
«Israël» dans l’impasse militaire et politique
L’expert palestinien Tayssir el-Khatib affirme que «l’entité sioniste est arrivée à une impasse dans sa tentative d’atteindre des objectifs politiques concrets lui permettant de revendiquer une victoire ».
Deux années de guerre dans une zone minuscule, face à une force qui ne possède qu’une infime fraction des capacités de l’armée «israélienne», n’ont pas suffi à libérer les captifs par la force, ni à mettre en œuvre le plan d’expulsion, ni à anéantir la résistance.
«Tous ces éléments ont poussé l’entité sioniste à accepter cet accord. Certains évoquent une pression américaine, mais je ne le crois pas : il s’agit plutôt de facteurs objectifs qui ont conduit à l’arrêt des hostilités. Cela ne signifie pas pour autant la fin de la guerre, mais une situation intermédiaire, entre la guerre ouverte et la trêve», ajoute-t-il.
Pourquoi le Hamas a accepté le plan Trump malgré les zones d’ombre ?
Mais qu’est-ce qui a poussé le mouvement de résistance palestinienne, le Hamas, à accepter le plan de Trump malgré plusieurs points non réglés jusqu’à présent ?
Le Dr Mohammad Halasa, universitaire et chercheur palestinien originaire d’al-Qods occupée (Jérusalem) occupée, explique que «les conditions sur le terrain ont poussé la résistance à accepter cet accord».
Premièrement, la force brutale utilisée par l’occupation a mis en évidence le déséquilibre du rapport de forces entre une résistance assiégée depuis quatorze ans et la puissance militaire la plus forte de la région, bénéficiant d’un soutien international sans précédent.
Deuxièmement, les corps démembrés du peuple palestinien ont constitué un fardeau insupportable pour la résistance, ce qui l’a conduite à accepter le plan proposé par Trump.
Troisièmement, l’incapacité du système international à freiner la fureur d’«Israël», ainsi que l’hypocrisie de la communauté internationale dans sa gestion de la question palestinienne, sont apparues clairement : elle a imposé des sanctions sévères à la Russie dès le début de la guerre en Ukraine, alors qu’«Israël» continue de bénéficier d’un appui international et de relations privilégiées avec l’Union européenne.
Les récentes mesures européennes ne sont rien d’autre qu’une tentative de calmer leurs opinions publiques révoltées par l’agression «israélienne».
Quatrièmement, le monde arabe a atteint un niveau inquiétant d’indifférence. Non seulement il a abandonné le peuple palestinien, mais certains régimes ont comploté contre lui.
Dans l’ensemble du monde musulman, personne ne semble se soucier du massacre de milliers de Palestiniens. La résistance a donc dû choisir entre deux options, toutes deux douloureuses.
Par cette démarche, la résistance tente de retirer à l’occupation tous les prétextes possibles et de dire à la communauté internationale comme au monde arabe : «Nous avons libéré les otages, il n’existe plus aucune justification à la poursuite de l’agression.»
Une trêve sans garanties et un équilibre précaire
M. Halasa confirme par ailleurs qu’il n’existe aucune garantie face à cet occupant : «Même dans la première phase, censée aboutir à la libération des prisonniers, Israël essaie déjà de manipuler la liste des détenus palestiniens à libérer en y ajoutant des noms de personnes condamnées à de courtes peines. En réalité, Israël comptait sur une réponse négative du Hamas pour poursuivre son agression».
Mais puisque la réponse du mouvement a été positive au plan de Trump, «Tel-Aviv» est passée à la mise en œuvre de la première phase, tout en gardant la possibilité de reprendre la guerre si le Hamas ne respectait pas ses engagements. Or, qui détermine si le mouvement s’y conforme ?
L’accord ne précise rien, ce qui laisse à Netanyahou toute latitude pour invoquer n’importe quel prétexte afin de relancer la guerre.
Le «Premier ministre israélien» estime désormais que la «société israélienne» a besoin d’une période de «convalescence» après la guerre, afin de restaurer ses relations internationales.
De son côté, Donald Trump s’est engagé à redorer l’image d’«Israël», ternie par ses agressions et sa guerre d’extermination contre le peuple palestinien. En même temps, «Israël» se sent aujourd’hui libre d’agir comme elle l’entend, sans aucune contrainte.
Le Dr Halasa explique : «L’extrême droite israélienne, dont le projet est fondamentalement colonial, a toujours besoin d’une guerre : c’est le cœur de son agenda. Israël ne peut survivre qu’en entretenant l’existence d’un ennemi extérieur, en maintenant la société coloniale dans la peur, en suscitant la compassion internationale et en se présentant continuellement comme une victime.»
Cette rhétorique sert à justifier d’éventuelles nouvelles guerres — contre l’Iran ou le Liban — sous prétexte de préserver sa sécurité face à la puissance du Hezbollah et aux missiles iraniens.
Ces choix demeurent cependant suspendus aux conditions internationales et à l’ampleur du soutien américain.
Il n’existe donc aucune garantie qu’«Israël» ne relance pas une nouvelle agression contre la bande de Gaza ou contre d’autres pays de l’axe de la résistance.
Mais cet axe, lui, reste vigilant, éveillé et préparé à toute aventure «israélienne» qui pourrait pousser la région du Moyen-Orient au bord d’une guerre d’une ampleur sans précédent.
Comments