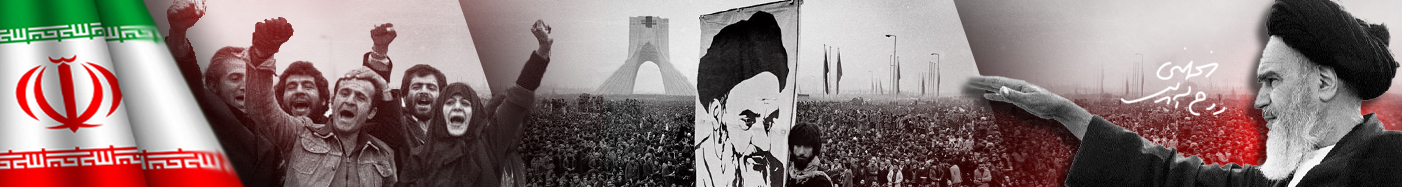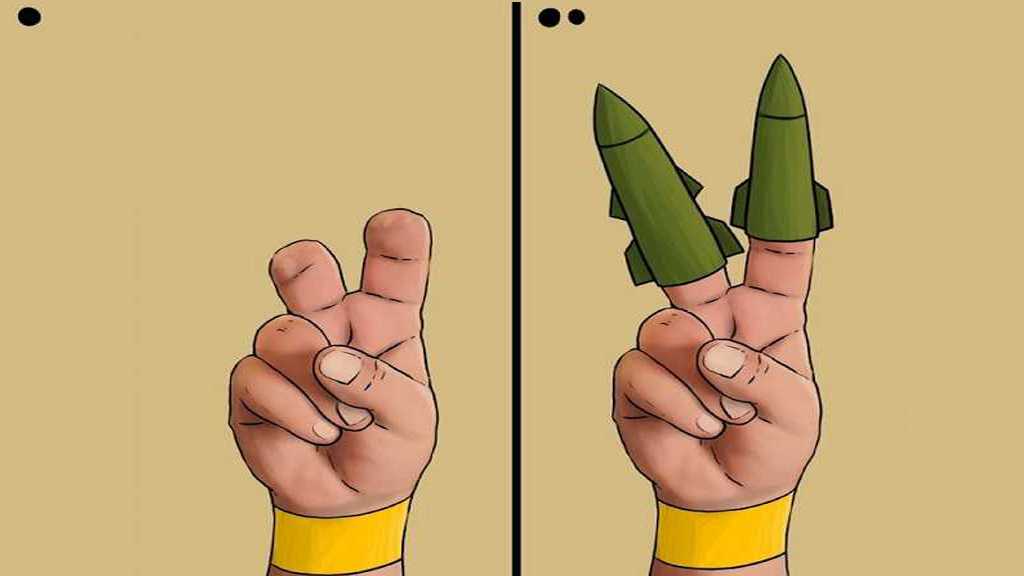Abdel Qader : L’esprit ardent de la résistance

Par Jihad as-Sayyed*
Quiconque examine l'expérience de la Résistance islamique au Liban découvrira le caractère unique de son parcours militaire. Depuis la fin de la guerre de juillet 2006, considérée comme un tournant dans l'histoire du conflit avec l'ennemi «israélien», la Résistance n'a eu d'autre choix que de reconstruire. Cependant, cette reconstruction devait se faire sur des bases plus solides et profondes, ce qui a poussé ses dirigeants à plonger dans les détails de la guerre, à décomposer ses éléments et à transformer les leçons en programmes pratiques, tout en forgeant une école militaire empreinte de sang et d'expériences.
Il est bien connu dans le domaine militaire, notamment en ce qui concerne l'organisation et la séquence des actions de commandement et des états-majors, que le département des opérations est chargé de concevoir, diriger et appliquer le processus de construction des forces et de préparation des armées à la guerre. Cela inclut l'entraînement, la qualification, la construction de capacités, le maintien de la disponibilité et la planification. Ainsi, comme dans d'autres armées et organisations militaires, la Résistance islamique a adopté ce modèle, établissant la fonction «opérations» au sein de sa structure militaire. Cette fonction a évolué d'une unité d'opérations centrales à un département des opérations, puis à une «Direction opérationnelle» avec le développement et l'expansion de la force militaire de la Résistance.
Au cours de ce processus, le nom du leader Ibrahim Aqil (Haj Abdel Qader) s'est distingué comme l'une des figures les plus marquantes ayant pris en charge la restructuration de l'appareil militaire de la Résistance, alliant la pensée militaire classique à l'innovation dans la lutte, tout en tirant parti d'un flot d'expériences. Cela va des batailles de Burj Abi Haidar et de Ghobeiry, où il s'est opposé avec ses frères aux tanks «israéliens» avançant vers Beyrouth, jusqu'à la direction des opérations centrales de la Résistance islamique et une grande partie du front de soutien aux frontières de la Palestine.
Revenant au contexte de l'appareil militaire de la Résistance, il est facile de constater que la construction du savoir militaire au sein de cette Résistance est de nature participative. En effet, elle résulte de la rencontre d'esprits et d'écoles collaborant et interagissant au sein des différentes couches de l'appareil militaire, de la direction militaire au sein du conseil jihadiste, jusqu'à l'expérience vécue par le combattant sur le terrain. Cette construction repose sur une nature cumulative, où chacun occupant un poste est responsable de l'établissement, de la construction et du fonctionnement, avant de passer le flambeau à son successeur qui continuera à bâtir sur ce qui a été réalisé.
Ainsi, chaque succès est le fruit des esprits, des efforts et des volontés de centaines de résistants ayant occupé des postes de commandement et de terrain depuis le début de la résistance jusqu'à nos jours. Parmi eux, le martyr Imad Moghniyeh (Haj Redwan), architecte fondamental de l'appareil jihadiste ; le martyr Mostapha Badreddine (Sayyed Zulfikar), pionnier de l'institutionnalisation du travail militaire ; le martyr Fouad Chokr (Sayyed Mohsen), stratège de premier plan ; le martyr Hassan Laqqis, fondateur de la branche technique ; et bien d'autres qui ont atteint le martyre ou qui sont toujours sur le terrain.
Après la guerre de 2006, la mission de restructurer le corps militaire de la résistance islamique a été confiée au haj Abdel Qader. Il a été l'un de ceux qui ont dirigé le processus d'extraction des leçons de cette confrontation décisive, supervisant directement une révision complète de l'expérience de la guerre. Cela a commencé par la documentation des événements, suivie de l'analyse des performances des unités, de l'identification des points forts et des faiblesses, et de la traduction de ces observations en plans de développement concrets.
Grâce à sa compréhension approfondie des fonctions du département des opérations, telles qu'elles sont présentées dans les doctrines militaires traditionnelles — planification, supervision, construction de capacités et préparation — haj Abdel Qader a transformé ce département d'une simple entité exécutive en un esprit dynamique, guidant un processus de renaissance stratégique complet. Cela a rendu la Résistance plus solide et mieux mobilisée pour les prochaines confrontations.
Haj Abdel Qader a étudié le célèbre philosophe et général chinois Sun Tzu, tirant de son livre «L'Art de la guerre» l'essence de la surprise et l'importance de «connaître son ennemi». Il a également bénéficié de la pensée du théoricien militaire britannique Liddell Hart, en ce qui concerne les principes de l'approche indirecte», qui consiste à ne pas affronter l'ennemi à ses points les plus forts, mais à ouvrir des brèches tactiques et à les exploiter à long terme. De plus, il a redéfini les théories du général Carl von Clausewitz, en particulier le concept de «Friction», en s'appuyant sur l'asymétrie entre la Résistance et l'ennemi.
L'effort du haj Abdel Qader ne s'est pas limité à la transmission, l'adaptation ou l'adoption de théories existantes. Il a innové en produisant des théories militaires propres, combinant ce qu'il appelait «le combat islamique», où les valeurs spirituelles prédominent, avec des concepts de planification moderne. Il cherchait à ancrer théoriquement et pratiquement une «école militaire islamique» spécifique à la Résistance islamique, fondée sur la moralité et la foi véritable, se manifestant dans la guerre asymétrique, un réseau opérationnel intégré, les modalités d'engagement, et la théorie de l'emploi des forces spéciales, entre autres.
Haj Abdel Qader a été l'un des pères fondateurs de la théorie du «combat de zone», qui repose sur la création d'unités autonomes en munitions, en informations et en liberté de décision. Ces unités continuent à combattre indépendamment de leur environnement et restent actives même en cas de perte de communication avec le commandement. Ce concept a renforcé la robustesse de la structure combattante, lui conférant une capacité de survie et de résistance dans les conditions les plus extrêmes.
À travers sa compréhension du système de combat de l'ennemi «israélien» et son suivi attentif de ses expériences au cours de plus de 40 ans de conflit, haj Abdel Qader a reconnu l'importance de former les unités d'infanterie et les forces spéciales de la résistance au «combat isolé». Il a conçu une approche en désaccord avec les pratiques habituelles dans les systèmes de formation à travers le monde, en préconisant d'offrir aux éléments une dose de connaissances leur permettant de planifier des actions individuelles et collectives possibles sans avoir à consulter le commandement.
Haj Abdel Qader a réussi à inventer une formule unique de pensée opérationnelle, intégrant les théories de combat classiques qui organisent les armées modernes avec les tactiques de combat de guérilla, flexibles et mobiles. Il n'y avait plus de distinction stricte entre la guerre conventionnelle et la guerre non conventionnelle, mais un chevauchement calculé a produit ce que les Américains appelleront plus tard «la guerre hybride».
Alors que la logique militaire traditionnelle associait l'utilisation de l'artillerie lourde ou des missiles guidés uniquement à la doctrine de l'armée conventionnelle, haj Abdel Qader a su déployer ces capacités dans des cadres plus petits et dispersés, agissant de manière asymétrique. Les lance-roquettes et l'artillerie de campagne sont devenues des armes de soutien pour les unités d'infanterie d'élite qui menaient des embuscades et des raids.
Cette combinaison de discipline classique et de flexibilité décentralisée a donné à la Résistance islamique une puissance multipliée, transformant sa structure d'un simple groupe de formations résistantes en une force militaire hybride capable d'épuiser une armée techniquement supérieure.
Les résultats de cette approche se sont manifestés clairement lors des affrontements que les combattants ont menés lorsque l'ennemi a commencé ses opérations terrestres dans la Bataille des Vaillants (Ouli el-Ba’es). Ils ont initié des raids, établi des embuscades et engagé le combat avec l'ennemi dans un environnement isolé, dans le cadre d'un combat commun planifié. Pendant que des groupes d'infanterie s'engageaient avec la brigade «Golani» dans le village de Chamaa, des unités «antichars» ciblaient les Merkavas à Hamoul, à Tayr Harfa et à al-Dheira. De même, lorsque des groupes d'infanterie ont affronté les brigades ennemies avançant vers la ville de Khiam, des roquettes et des drones pleuvaient sur les arrières des forces avancées à Mtollé et dans la vallée Al-Assafir. Ces faits ont été qualifiés par l'ennemi d’«évènements sécuritaires difficiles» à Aitaroune, Adaisseh, Chamaa, Tayr Harfa, Khiam, Markaba et Beit Yahoun.
Haj Abdel Qader croyait fermement que la bataille contre cet ennemi était multidimensionnelle. Il soulignait la nécessité d'un équilibre dans la préparation à la mener sous tous ses aspects, pas seulement militaires, mais aussi spirituels, moraux et de sensibilisation. Il accordait une attention particulière aux dimensions morales et insistait sur l'importance de commencer chaque leçon ou conférence par un passage religieux, moral et culturel, servant d'introduction au sujet. Il considérait que la construction de l'esprit combattant était la pierre angulaire de toute victoire.
Il a supervisé directement le projet de la série «Les Secrets de la Libération II», où il a redéfini le récit de la victoire sur le terrorisme qui menaçait le Liban dans les montagnes de la Békaa, en utilisant un style alliant documentation précise et message mobilisateur.
Haj Abdel Qader s'est également investi personnellement dans le «Musée de Baalbek de la résistance», qui n'était pas seulement une exposition matérielle, mais un espace symbolique visant à renforcer la confiance et l'appartenance populaire à la Résistance. Il insistait sur le fait que chaque pièce d'équipement ennemi exposée dans le musée devait être accompagnée d'une fiche informative détaillant ses spécifications techniques, ses usages tactiques et sa provenance, dans un souci de promouvoir la culture militaire au sein de la société. Il suivait de près chaque détail, allant jusqu'à la conception, les couleurs et les messages moraux à transmettre.
Son amour pour la vulgarisation du savoir et de la connaissance l'a conduit à consacrer du temps dans son emploi du temps chargé à donner des conférences de qualité à différents niveaux au sein du Hezbollah, allant des cadres de terrain aux leaders opérationnels. Il croyait fermement que la construction de la force commence par la construction des esprits. Rare est le combattant ou l'officier de la Résistance qui n'a pas assisté au moins une fois à un cours ou à une conférence du Haj, malgré la prise en compte des considérations de sécurité et de la fatigue physique... Il était connu comme l'homme qui ne dort jamais.
Avec toute la reconnaissance que ces mots peuvent contenir, haj Abdel Qader restera une école unique, qui n'a pas seulement laissé ses empreintes sur le chemin de la Résistance, mais aussi sur l'ensemble de la pensée militaire moderne. Ses idées et théories, ainsi que celles de ses camarades martyrs, chefs et combattants, constitueront un phare et un guide dans le cadre du chemin inévitable vers le rétablissement et la reconstruction.
*Article paru dans le quotidien libanais al-Akhbar, traduit par l’équipe du site