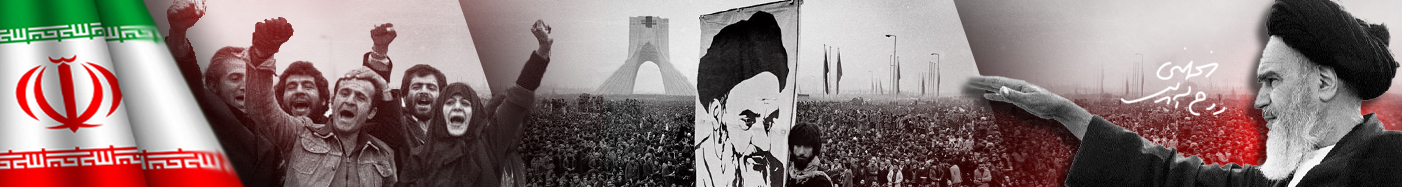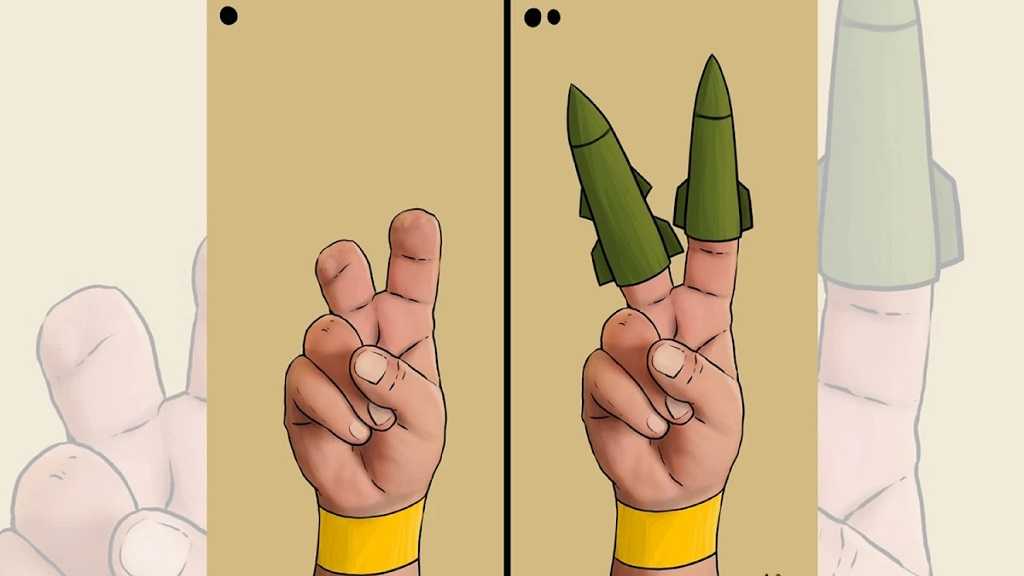Le crime des bipeurs: L’illusion d’un coup fatal, qui n’a pas mis fin au Hezbollah
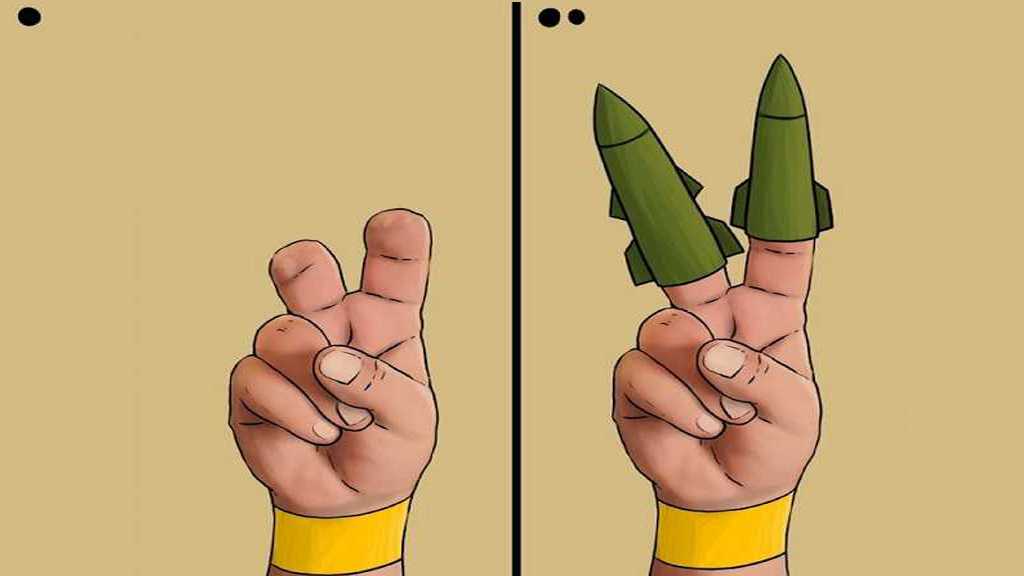
Par Ali Haidar*
«Israël» voulait que le crime des bipeurs soit un coup fatal au-delà de l'imaginaire. Cependant, malgré les pertes, le Hezbollah a réussi à combler les lacunes rapidement et a prouvé sa capacité à se réinventer plus rapidement que ce que même ses alliés les plus proches pouvaient prévoir.
Au premier anniversaire du crime des bipeurs et des talkies-walkies, l'importance de cet événement se révèle comme l'un des sommets sans précédent dans le parcours de la confrontation entre la Résistance et l'ennemi «israélien».
L'attaque massive n'était pas simplement une opération militaire majeure, mais une étape réfléchie pour traduire la supériorité technologique et des renseignements «israéliens» en une arme complexe frappant à la fois le corps et la conscience.
Cette attaque a impliqué trois dimensions interconnectées : opérationnelle, psychologique et dissuasive.
Dans cette optique, l'opération visait à provoquer un choc stratégique semblable à celui des «armes de destruction massive», en raison de sa capacité à infliger des dommages matériels, psychologiques et moraux considérables, transformant le saignement humain en un outil préparant des renversements politiques et militaires décisifs.
Dimension opérationnelle
Selon les évaluations «israéliennes», l'objectif de la frappe était de provoquer une quasi-paralysie de la structure de la Résistance en neutralisant des milliers de combattants aux compétences variées. Bien que les pertes aient été importantes, et que le plan - selon les aveux du «ministre de la Guerre» Yoav Galant - visait à éliminer environ 15 000 résistants, les résultats se sont révélés différents.
Le Hezbollah a pu combler rapidement les lacunes et a prouvé qu'il possédait une vaste base de compétences professionnelles et idéologiques capables d'absorber le choc et de remettre en marche la machine de la Résistance en un temps record. Ce maintien a renforcé l'image du parti en tant qu'institution flexible et dynamique, reposant non pas sur des individus, mais sur un système complet capable d'apprendre et de s'adapter. Il ne s'agissait pas seulement de conserver la mobilisation, mais l'activité de lancement de missiles et le soutien logistique qui ont continué à créer une confusion évidente dans les calculs «israéliens» par la suite.
Cette expérience a également engendré une nouvelle génération de leaders de terrain, forgés au feu, qui ont imposé de nouvelles équations, confirmant que la Résistance n'est pas simplement une structure opérationnelle rigide, mais un environnement vivant capable de se renouveler. Toute frappe - même si elle revêt des dimensions mythiques - peut se transformer en une leçon pratique de construction et de repositionnement, et une en une preuve sur la capacité du parti à se réinventer rapidement dépassant même les attentes de ses alliés les plus proches.
Dimension psychologique
«Israël» misait sur le fait qu'un coup «au-delà de l'imaginaire» paralyserait l'appareil psychologique de la Résistance et sèmerait la peur dans son environnement. Cependant, la doctrine du martyre a renversé cette équation. En effet, l'opération, au lieu d'engendrer un repli, a approfondi la motivation à faire face à un ennemi qui semblait cibler les êtres humains plutôt que les armes, surtout en parallèle de sa guerre contre les civils. Ce parallélisme a créé un nouveau récit selon lequel chaque frappe israélienne est perçue comme une attaque contre l'humanité, ce qui a renforcé l'engagement de la communauté entourant la Résistance et transformé la tragédie en un outil culturel qui a renforcé la légitimité morale et l'engagement populaire.
Dimension dissuasive
L'ennemi croyait qu'un coup de cette ampleur établirait une équation de dissuasion et ouvrirait la voie à la soumission de la Résistance. Cependant, un an après, il est devenu évident que le Hezbollah n'avait pas été brisé et n'avait pas renoncé à ses principes, mais avait au contraire, a renforcé sa résilience interne et établi une dynamique de confrontation plus complexe. «Israël» a dû faire face à la réalité selon laquelle la résistance n'est pas simplement une structure opérationnelle, mais une communauté idéologique cohérente.
La résistance a prouvé qu'elle possédait une base large de compétences capables d'absorber le choc en un temps record et, stratégiquement, l'opération a constitué un test de la capacité de la Résistance à surmonter les blessures. Il est devenu évident qu'elle a transformé chaque élément de la frappe en une opportunité pour développer ses capacités et ses infrastructures, qu'elles soient humaines, logistiques ou de sécurité.
Leçons pour l'avenir
Au-delà de ses dimensions opérationnelles, psychologiques et dissuasives, le crime a transmis des messages technologiques, intelligents et éthiques profonds. Il a révélé l'introduction d'outils et de formes de confrontation qui, jusqu'à récemment, semblaient relever de la science-fiction. En parallèle, il a ouvert des perspectives pour la Résistance afin de se réinventer en adéquation avec ce nouveau mode de guerre, transformant le crime en un laboratoire réel pour tester la capacité d'adaptation et élaborer des plans de défense et d'attaque innovants utilisant des outils et des méthodes modernes.
Cette étape montre que la supériorité technique, quelle que soit son avancée, perd de son efficacité lorsqu'elle fait face à une structure idéologique, politique et morale solide. «Israël» espérait provoquer un choc opérationnel, un effondrement psychologique et une dissuasion permanente, mais l’ennemi s'est heurté à une réalité différente : une Résistance qui transforme chaque frappe en leçon et chaque perte en carburant pour sa survie.
Ainsi, la Résistance se renouvelle et se réinvente pour répondre aux exigences de la confrontation moderne, révélant une disposition illimitée au sacrifice et une volonté inébranlable face à la «science-fiction» de l'ennemi. Il devient clair que le conflit n'est plus simplement un échange de coups, mais une bataille pour l'existence entre un système hostile et un peuple dont la résistance incarne la volonté de transformer la perte en énergie renouvelable. Dans cette dynamique, le processus d'apprentissage et d'adaptation avance plus rapidement que l'illusion du «coup fatal», confirmant que la guerre n'est pas seulement une bataille d'armement, mais aussi une lutte pour la conscience et la volonté.
*Article paru dans le quotidien libanais al-Akhbar, traduit par l’équipe du site