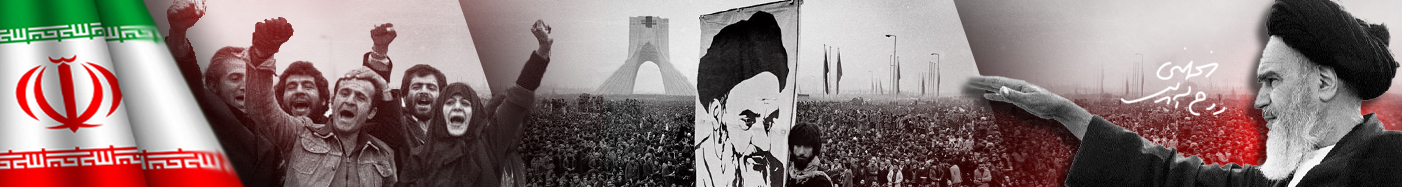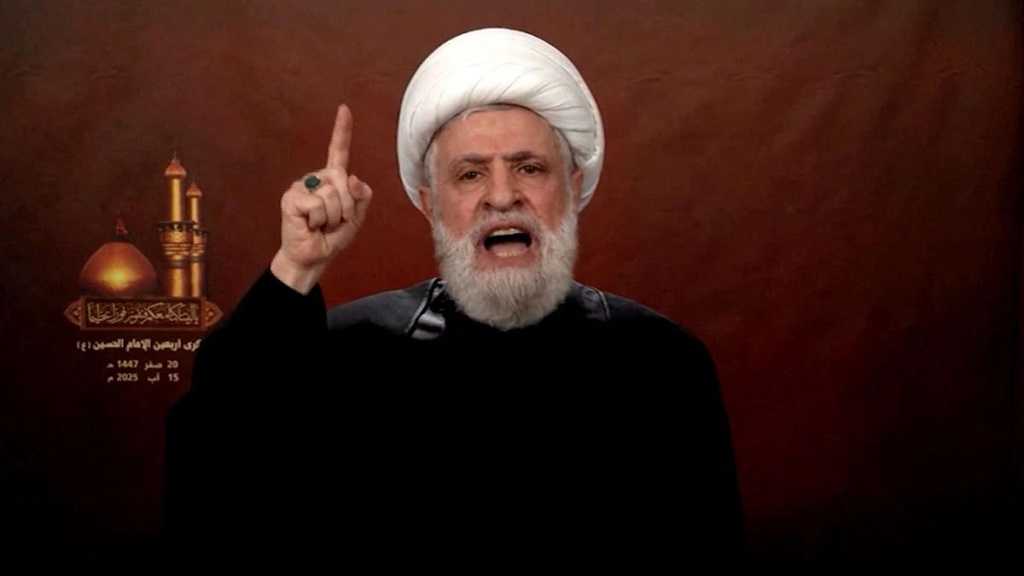Liban: Entre la menace «israélienne» et la pression politique

Par Ahmad Yassine
Au cœur des grandes transformations géopolitiques qui secouent la région de l'Asie de l'Ouest, la scène libanaise se retrouve à nouveau au centre des tensions internationales et régionales. Après une guerre dévastatrice à Gaza et l'éclatement d'une confrontation directe entre les États-Unis et «Israël» d'une part, et l'Iran d’autre part, en plus des changements structurels en Syrie avec l'émergence d'un nouveau régime dirigé par Ahmed Charaa, aligné sur les politiques occidentales et normalisatrices, le système occidental cherche à redessiner la carte des influences en Asie de l'Ouest.
Cela se fait en visant à neutraliser les forces de la Résistance et à créer de nouveaux équilibres qui permettraient à «Israël» de s'affirmer et de contrôler la région.
Dans ce contexte, le Liban est utilisé comme un terrain d'essai pour imposer de nouvelles réalités, tantôt par des moyens doux, tantôt par des menaces plus brutales.
Les pressions américaines et françaises dominent la scène, parallèlement à une intensification sans précédent de l’intimidation «israélienne», qui menace de mener une large offensive si la Résistance ne remet pas ses armes.
L'envoyé américain, Thomas Barrack, a lancé des messages très fermes au gouvernement libanais, avertissant que le maintien des armes par le Hezbollah signifierait la fin de tout soutien ou médiation américaine, tout en liant cela à une proposition demandant une décision ministérielle officielle reconnaissant le monopole des armes entre les mains de l'État.
En revanche, «Tel-Aviv» a affirmé par la voix de ses responsables militaires et politiques que l'alternative à «la soumission libanaise» serait une opération militaire qui n’épargnerait pas le sud du Liban, voire au-delà.
Le discours français, bien qu'il ait été plus diplomatique, portait également en lui une inquiétude évidente face à l'escalade militaire «israélienne» imminente, si la situation reste inchangée. Cependant, Paris, comme d'autres capitales européennes, ne montre pas de réelle disposition à dissuader «Israël» ou à lui imposer des règles claires, ce qui permet à «Tel-Aviv» de poursuivre une politique de «pression ascendante» sans freins.
Dans ce cadre, deux scénarios peuvent être envisagés :
Premier scénario : Agression de grande envergure contre le Liban
La stratégie d'«Israël» après la guerre de Gaza repose sur la nécessité de détruire complètement l'infrastructure militaire de la Résistance, et non simplement la contenir.
Les déclarations de Thomas Barrack et l'absence d'un engagement américain clair pour freiner «Israël» laissent entendre une autorisation implicite pour l'escalade.
Le contexte régional évolue en faveur de l'ennemi. La Syrie est aujourd'hui fragmentée et affaiblie, ne soutenant pas les forces de la Résistance, tout comme l'Irak, qui fait face à un grand danger et à une menace américaine directe, tentant de prévenir les tensions sécuritaires et de maintenir la stabilité. L'Iran, quant à lui, tente de gérer les conséquences des récentes agressions tout en souffrant de graves crises économiques dues aux sanctions.
Cette évaluation conduit les États-Unis et «Israël» à croire que la Résistance au Liban pourrait être relativement isolée, ce qui incite l’ennemi à envisager un coup décisif. De plus, un discours politique et médiatique occidental en préparation, évoquant des «armes illégales», sert à justifier la guerre comme un moyen de «restaurer la souveraineté».
Cependant, une invasion terrestre à grande échelle serait très coûteuse, tant humainement que militairement et politiquement pour «Israël», et ses résultats ne seraient pas garantis. Quelle serait la réaction du «gouvernement» de Netanyahu si les colonies du nord subissaient des salves de roquettes, ou si «Haïfa», voire «Tel-Aviv», étaient ciblées ? Les responsables «israéliens» eux-mêmes affirment que le Hezbollah n'a pas été brisé malgré les frappes et conserve une capacité de feu importante, susceptible d'enflammer complètement le front nord.
Deuxième scénario : Agression limitée et intensification des menaces médiatiques et politiques
Ce scénario, plus probable, se caractérise par des actions limitées d'«Israël» et une intensification des menaces médiatiques et politiques.
Dans ce cadre, «Israël» pourrait mener des opérations ciblées par des frappes aériennes et des drones, visant certaines installations secondaires ou connues de la Résistance, comme cela a été le cas depuis l'arrêt des hostilités, ou procéder à des assassinats ciblés de chefs militaires tout en augmentant le niveau de menace d'une large invasion terrestre.
Cette approche vise à utiliser le bombardement comme un outil de pression pour obtenir des concessions politiques, que ce soit de l'État libanais ou du milieu politique du Hezbollah. Cela s'accompagne d'une pression économique et diplomatique, ainsi que de l'activation d'instruments internes libanais appelant à désarmer la Résistance en échange de stabilité ou d'aides. Ce type d'escalade a des coûts bas pour «Israël» et pourrait lui permettre de réaliser des gains politiques sans l'engager dans une guerre prolongée aux résultats incertains.
Cependant, dans les deux cas, il est impossible d'ignorer les points forts de la Résistance au Liban. Malgré les frappes et les assassinats, le Hezbollah conserve des capacités militaires capables de paralyser le front intérieur «israélien». De plus, il bénéficie d'un large soutien populaire et d'un réseau régional qui le voit toujours comme un fer de lance dans la lutte contre le projet occidental-«israélien».
Les expériences de l'agression de juillet 2006 et des batailles qui ont suivi, tant politiques que militaires, ont prouvé que la Résistance n'est pas un corps fragile qui peut être brisé par des menaces, mais un système solide capable de contenir la pression et de se repositionner sans renoncer à l'essence de son rôle.
Ainsi, tout pari sur une obédience ou un abandon total pourrait être illusoire. La pression occidentale, aussi intense soit-elle, peut réussir à briser certains outils, mais elle ne pourra pas extirper la croyance qui sous-tend ce projet tant que l'environnement stratégique global ne change pas.
En conclusion, ce qui se passe aujourd'hui au Liban n'est qu'un chapitre de la lutte pour l'avenir de la région, entre un projet de fragmentation dirigé par Washington et «Tel-Aviv» à travers des agents locaux, et un projet de résistance qui cherche à préserver l'équilibre de la dissuasion et la souveraineté. Entre ces deux projets, se trouve la décision de résister et de faire face sur différents fronts.
Comments