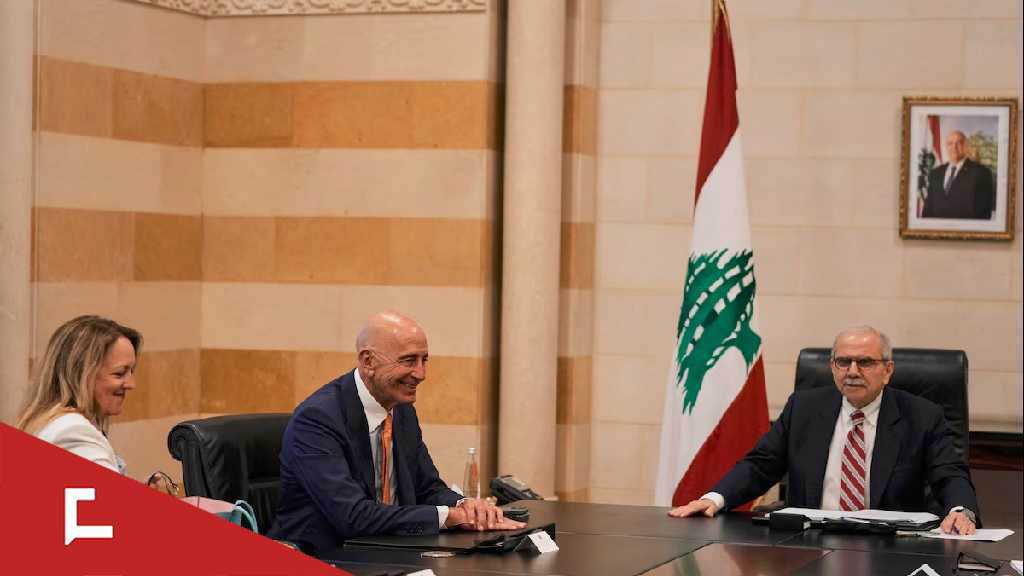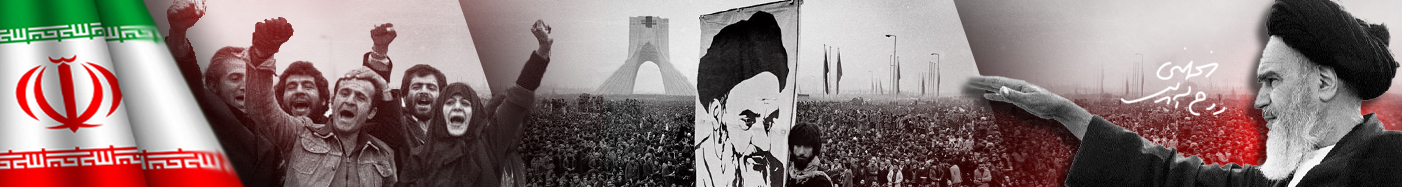Le retrait de l’UNESCO par les États-Unis, une atteinte pour le «soft power» américain

Par Assia Husseini
Pour la troisième fois de leur histoire, les États-Unis ont annoncé leur retrait de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Ils accusent l’organisation d’être injuste envers «Israël» et de soutenir des causes jugées polémiques et sources de division.
«Le président Trump a décidé de retirer les États-Unis de l’UNESCO — une organisation qui soutient des idées culturelles et sociales woke et clivantes, totalement contraires aux politiques de bon sens que les Américains ont choisies lors des élections de novembre», a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche, Tamy Bruce, dans un communiqué publié sur le site du ministère américain des Affaires étrangères.
Le communiqué ajoute que l’admission de «l’État de Palestine» comme membre à part entière est un autre point de discorde, car elle va contre la politique des États-Unis et favorise, selon eux, un discours hostile à «Israël».
Il conclut en affirmant que «ce président mettra toujours l’Amérique en premier et veillera à ce que l’adhésion des États-Unis à toute organisation internationale soit en accord avec nos intérêts nationaux».
Les États-Unis ont informé la directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, de leur décision mardi dernier. Le retrait sera effectif le 31 décembre 2026, jusqu’à cette date, ils resteront membres à part entière.
Le premier retrait des États-Unis de l’UNESCO remonte à 1984, sous la présidence de Ronald Reagan. À cette époque, l’administration américaine estimait que l’organisation était devenue trop politisée, mal gérée financièrement, trop centrée sur le désarmement durant la guerre froide, et opposée à l’économie de marché ainsi qu’à la liberté de la presse.
En réalité, l’UNESCO essayait de garder une position équilibrée entre les blocs de l’Est (URSS) et de l’Ouest (États-Unis), en accord avec sa mission de dialogue entre les cultures et les nations. Mais dans un monde divisé, cette neutralité était souvent mal perçue. Les États-Unis ont vu dans certaines décisions de l’UNESCO une proximité avec le bloc soviétique, alors que d’autres pays y voyaient une volonté d’indépendance vis-à-vis de toutes les puissances.
Les États-Unis ont ensuite réintégré l’UNESCO en 2003, sous George W. Bush. Mais en 2017, lors du premier mandat de Donald Trump, ils ont de nouveau décidé de se retirer. Cette fois, l’administration américaine reprochait à l’UNESCO d’être systématiquement contre «Israël», notamment à cause de l’inscription de plusieurs sites palestiniens au patrimoine mondial. Washington a considéré cela comme un usage politique de l’organisation.
D’ailleurs, depuis 2011, les États-Unis avaient déjà suspendu leur financement à l’UNESCO, après l’admission de la Palestine comme État membre. Cette décision faisait suite à une loi américaine interdisant de financer une agence de l’ONU qui reconnaît un État palestinien.
Ce nouveau retrait, pourrait être vu comme un message politique clair envoyé à ceux qui soutiennent la reconnaissance d’un État palestinien, surtout dans le contexte de la guerre «israélienne» contre Gaza. Il intervient aussi alors que certains pays occidentaux veulent avancer vers la solution des deux États.
Ce retrait aura sans doute des conséquences pour les deux parties. Même si l’UNESCO a affirmé s’être préparée à une telle éventualité, la sortie américaine pourrait affecter plusieurs programmes : éducation, protection du patrimoine, liberté de la presse, ou encore coopération scientifique, notamment dans les pays en développement.
En se retirant, les États-Unis abandonnent aussi un outil important d’influence dans les discussions internationales sur les normes culturelles, éducatives et scientifiques. Ce vide pourrait être comblé par d’autres puissances comme la Chine, la Russie ou certains pays européens, ce qui changerait les équilibres politiques au sein de l’organisation.
Mais c’est surtout sur le plan du soft power que ce retrait peut avoir un impact important. Il donne l’image d’un pays qui préfère la force au dialogue et à la coopération. Cela nuit à la réputation des États-Unis comme défenseurs des droits humains et de la démocratie, notamment auprès des jeunes générations et des intellectuels du Sud global.
Depuis le début de l’offensive «israélienne» contre Gaza et le soutien total des États-Unis à «Israël», le soft power américain, fondé sur l’image d’un pays juste, libre et humain, a été fortement affaibli.
La guerre à Gaza est largement relayée sur les réseaux sociaux. Les témoignages, les images de destructions et les appels à la justice y circulent massivement. Les prises de position américaines sont souvent perçues comme froides et indifférentes, ce qui abîme encore plus leur image dans le monde arabe, en Afrique et en Amérique latine.
De plus, le rejet répété des institutions internationales par Washington, comme l’UNERWA par exemple, surtout lorsqu’elles critiquent «Israël», donne l’impression que les États-Unis se placent au-dessus des règles. Cela affaiblit l’influence qu’ils ont mis des décennies à construire.
Même si les États-Unis restent très puissants sur le plan militaire, économique et technologique, leur pouvoir d’attraction est aujourd’hui remis en question. Cette perte d’influence est visible dans de nombreux pays du Sud, mais aussi dans certains milieux des sociétés occidentales, y compris à l’intérieur même des États-Unis.
Comments