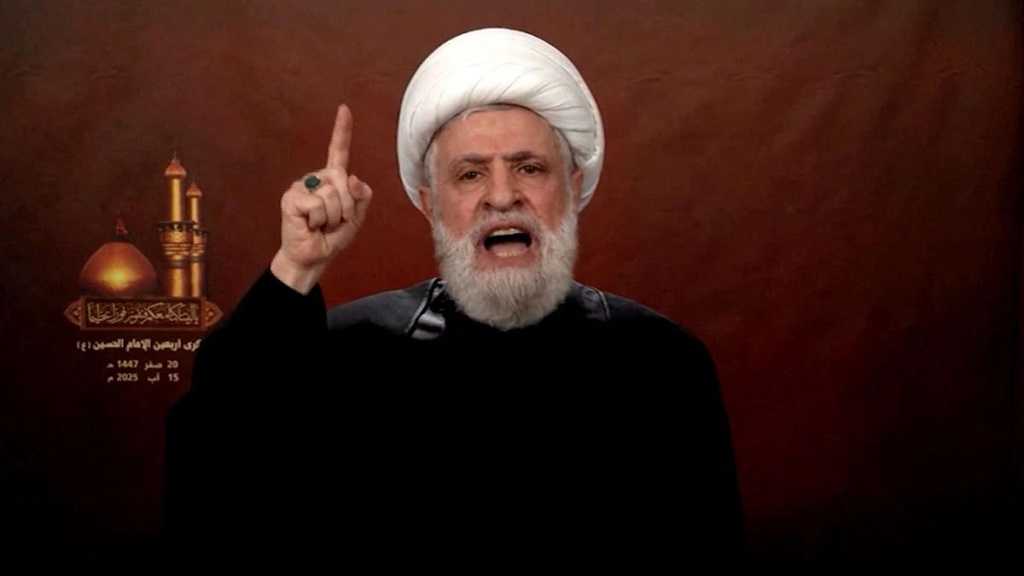L’Asie de l’Ouest, à l’intersection de la dissuasion intelligente et de la diplomatie avisée

Par Abbas Araghchi*
«La réponse de la République islamique d'Iran à la demande de cessation des hostilités ouvre une nouvelle fenêtre pour une diplomatie intégrale, offrant à toutes les parties désireuses de paix l'occasion de réévaluer leurs approches. Cependant, l'engagement dans des négociations et le succès de la diplomatie nécessitent de prendre en compte des conditions fondamentales.
Il y a des décennies, lorsque la cause de la Palestine a été présentée comme une «affaire centrale» dans le monde islamique et l'espace arabe, peu de gens auraient imaginé que l’Iran jouerait un rôle crucial et actif à ce propos. Aujourd'hui, après que l'entité sioniste a demandé un cessez-le-feu temporaire, la République islamique d'Iran, a non seulement confirmé sa position influente, mais a également démontré qu'un changement significatif s'était produit dans l'équilibre des forces dans la région.
Concernant cette transformation, il convient de s'arrêter sur deux points clés.
Premièrement, la résistance efficace menée par la République islamique d'Iran pour défendre sa souveraineté et l'intégrité de son territoire, ainsi que sa réponse décisive à l'agression «israélienne» au cœur des territoires palestiniens occupés, a conduit à l'effondrement de l'image de puissance artificielle de l'entité sioniste, qui s'était longtemps appuyée sur le soutien inconditionnel des États-Unis et de ses alliés. Deuxièmement, la réponse iranienne s'est fondée sur la résolution n° 69/51 adoptée lors de la 51e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique, qui a été approuvée par consensus de tous les États membres, formant ainsi une position unie et un consensus collectif.
Les membres de l’OCI ont considéré que les opérations militaires dirigées contre la République islamique d'Iran constituent un «acte d'agression», conformément à l'article 2 (4) de la Charte des Nations unies, et ont affirmé que les actes commis par l'entité sioniste constituent, selon les règles du droit international humanitaire, un «crime de guerre».
Dans une autre partie de cette résolution, 57 États islamiques ont demandé à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) de condamner l'attaque contre les installations nucléaires iraniennes par les États-Unis et l'entité israélienne, et de soumettre un rapport au Conseil de sécurité concernant cette violation flagrante des normes internationales.
Ce qui distingue aujourd'hui la réalité de la Oumma islamique et de notre région par rapport au passé, c'est que la scène de solidarité et d'unité nationale observée au sein de la société iranienne après ces agressions s'est étendue aux arènes régionale et islamique. Nous ne trouvons de similaire à cette situation que lors de l'année 1969, lorsque les sionistes ont envahi la mosquée Al-Aqsa et y ont mis le feu à certaines parties de «la première Qibla».
Bien que le Conseil de sécurité ait alors adopté la résolution 271 condamnant fermement les actes de l'entité israélienne, ce qui a eu un impact encore plus profond a été la décision de l'Organisation de la conférence islamique de tenir le premier sommet islamique sur la Palestine.
À mon avis, ce que le sommet de Rabat en septembre 1969 a établi, en considérant la cause de la Palestine comme un point de départ pour l'action islamique commune, se manifeste aujourd'hui à travers la récente réunion des ministres des Affaires étrangères des pays islamiques. Cela a permis de parvenir à une approche commune après des décennies, afin que les États islamiques établissent les bases d'un nouveau dialogue réaliste, reflétant les aspirations de leurs peuples ; un dialogue où les appartenances nationales, confessionnelles et linguistiques, ainsi que les divergences politiques et les rivalités traditionnelles et géopolitiques, ne prévalent pas.
En effet, le principe de «protection des droits collectifs des peuples et des États de la région» est devenu un point commun dans les positions des pays au cours des deux dernières semaines, soulevant de nouvelles questions : le Monde islamique est-il convaincu de jouer un rôle actif à un moment où un nouveau système mondial multipolaire et plus indépendant émerge ? Les questions de la Palestine, de la dignité et du développement sont-elles devenues prioritaires pour l'attention collective des États de la région et des sociétés islamiques ?
Les 15 derniers jours, ou les «jours de puissance», ont été à la fois un test pour la cohésion de la stratégie de dissuasion et de la diplomatie régionale iranienne, et un test de la volonté du monde islamique de faire face à des menaces communes. Pour la première fois depuis le sommet de l'Organisation de la coopération islamique à Rabat, le monde islamique adopte un nouveau discours islamique caractérisé par le réalisme et la force, auquel aucun État membre n'a fait défaut.
La base fondamentale de la dissuasion se concrétise dans la coopération entre les États de la région. L'accord face aux menaces communes, l’approche concernant la stabilité régionale, la sécurité économique et la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes constituent les quatre piliers autour desquels devraient s'organiser les négociations diplomatiques.
Ainsi, la réponse de la République islamique d'Iran à la demande de cessation des hostilités ouvre une nouvelle fenêtre pour une diplomatie globale, offrant à toutes les parties désireuses de paix l'occasion de réévaluer leurs approches. Cependant, l'engagement dans des négociations et le succès de la diplomatie nécessitent de prendre en compte des conditions fondamentales.
Les premières étapes de ce processus résident dans le suivi des questions de «garantie de sécurité» et de «l’instauration de la justice».
En ce qui concerne la garantie de sécurité, celle-ci ne peut être obtenue qu'en légalisant la demande de cessation des hostilités et en demandant à l'agresseur des garanties de ne pas recourir à la violence dans l'avenir. Or, cela a fait défaut dans les dossiers de Gaza et du Liban, entraînant la poursuite des violations, par l'entité sioniste, du cessez-le-feu convenu et le mépris pour la stabilité de la région méditerranéenne.
Il est essentiel que le Conseil de sécurité assume ses responsabilités conformément à la Charte des Nations unies et qu'il agisse de manière urgente et immédiate pour obtenir les garanties nécessaires de la part de l'agresseur.
Il ne fait aucun doute que les membres influents du Conseil de sécurité, tels que la Chine, la Russie et l'Europe, ainsi que des pays comme le Brésil et le Japon, qui considèrent la protection de la paix internationale comme une de leurs responsabilités, peuvent jouer un rôle constructif dans la réalisation de cet objectif.
Je tiens à souligner que mon pays, l'Iran, appelle depuis des décennies à un Moyen-Orient exempte d’armes nucléaires afin de garantir la sécurité régionale et a prouvé son engagement envers cette vision.
Parallèlement à cette approche, il est crucial de se concentrer sur le consensus collectif entre les États islamiques et de travailler à l'élaboration de modèles de développement économique, à travers des idées telles que l'investissement et les accords commerciaux régionaux, considérés comme des outils pour atténuer les tensions dans les conditions actuelles.
En ce qui concerne l’instauration de la justice, l'idée énoncée dans le paragraphe 2 de la résolution 69/51 de l'Organisation de la coopération islamique est pertinente. La condamnation explicite par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) des attaques menées par l'entité israélienne et les États-Unis contre les installations nucléaires pacifiques en Iran – telles que celles de Natanz, Fordo et Ispahan – doit prendre une dimension pratique et exécutive. Il ne faut pas oublier que la demande de cette condamnation est survenue dans le contexte d'agressions visant des installations entièrement soumises aux garanties de l'AIEA.
On peut envisager la garantie de sécurité et l’instauration de la justice comme une première étape dans un long parcours visant à joindre le «moment de cessation des hostilités» à un «horizon de paix durable». Sans aucun doute, la région de l'Asie de l'Ouest se trouve aujourd'hui à un carrefour historique crucial : soit continuer dans un cycle de violence sans fin, soit s'orienter vers une paix solide et durable. Il est temps pour le monde islamique de réfléchir à un avenir plus stable et durable, au lieu de s'appuyer sur des politiques à court terme.
Dans ce même contexte, la deuxième étape vers la paix est étroitement liée à la position centrale du Liban et de la Palestine en tant que deux États du monde islamique. Cette orientation nécessite une attention particulière, de toutes les parties, pour Gaza et le Liban, qui ont été les plus touchés par l'agression, les meurtres et l'occupation organisée au cours de l'année et demie écoulée.
La République islamique d'Iran, comme tous les pays islamiques, considère que la condition essentielle pour gérer le conflit est l'arrêt immédiat de l'agression et de l'occupation contre Gaza et le Liban, tout en fournissant une aide humanitaire urgente et une participation sérieuse de la communauté internationale à la reconstruction de ces deux régions.
En plus des mesures exécutives constructives mentionnées, il est impératif de prendre en compte la création et la formulation d'un cadre ou d'une plateforme d'exécution. L'établissement d'un organe juridique et de droits, tel qu'une «Cour des droits humains islamiques», fondé sur les principes juridiques reconnus dans le monde islamique, comme la Déclaration du Caire de 1990, pourrait constituer une exigence complémentaire dans ce contexte.
Cette cour devrait, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme, bénéficier d'un large soutien international. La création d'un tel mécanisme permettrait aux États membres de l'Organisation de la coopération islamique de jouer un rôle plus actif dans le processus de solidarité et de coopération.
En outre, la présidence actuelle de la Turquie, en tête de l'Organisation de la coopération islamique, offre l'opportunité de former un comité préparatoire pour rédiger rapidement les statuts, et arranger la coopération entre le monde islamique et les institutions internationales, comme la Cour pénale internationale, en se concentrant sur des dossiers spécifiques tels que la question de Gaza.
Du point de vue de la République islamique d'Iran, la paix et la stabilité collective en Asie de l'Ouest – une région exempte d'armes nucléaires – ne sont pas seulement possibles et à portée de main grâce à une coopération conjointe axée sur le destin collectif, mais elles sont également indispensables.
Article écrit par le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran, Abbas Araghchi, dans le quotidien libanais An-Nahar
Comments