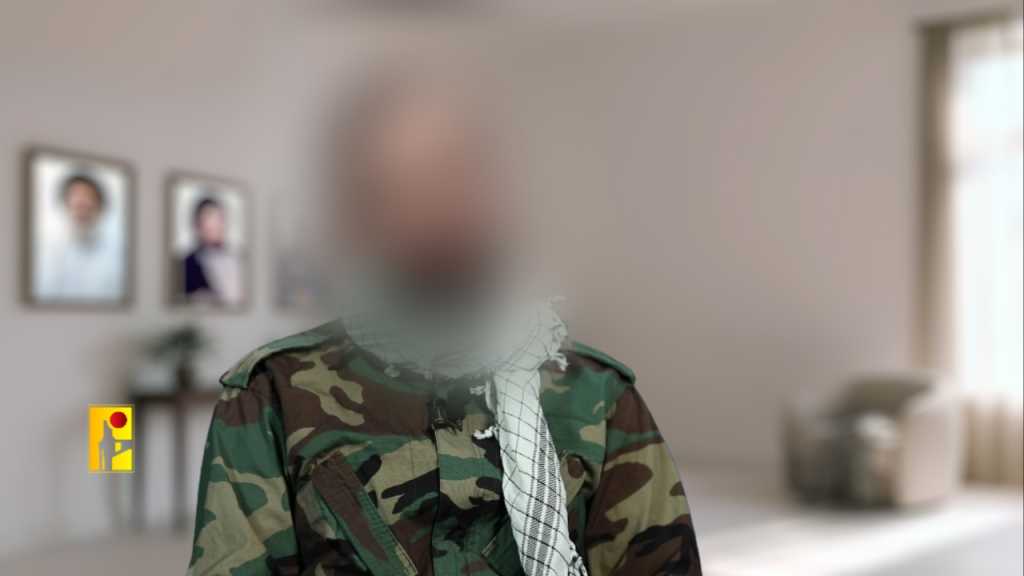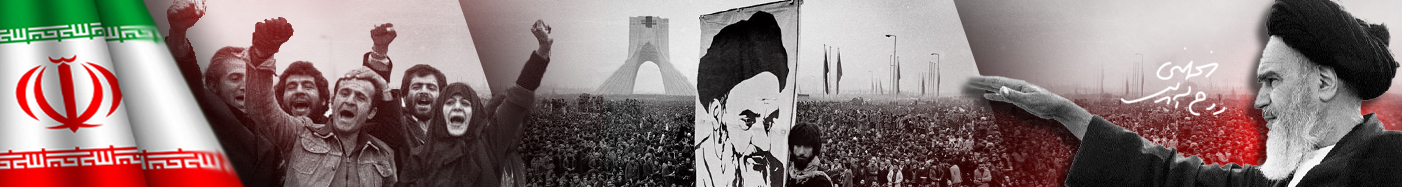Tensions croissantes entre Washington et Caracas : vers une confrontation ouverte?

Par Assia Husseini
Les États-Unis ont massivement renforcé leur présence militaire dans les Caraibes, ce qui laisse penser que l’administration Trump se prépare à étendre ses opérations dans la région. Selon The Washington Post, cette montée en puissance augmente la tension entre Washington et Caracas et fait craindre une première attaque américaine contre le Venezuela.
Une présence militaire américaine sans précédent dans les Caraïbes
Depuis août 2025, les États-Unis ont commencé à déployer des navires de guerre et du matériel militaire près des côtes vénézuéliennes, sous prétexte de vouloir lutter contre le trafic de drogue.
Le 14 août, la Maison-Blanche a annoncé l’envoi de forces aéronavales dans le sud de la mer des Caraïbes dans le cadre d’une campagne «anti-cartels».
En réaction, le Venezuela a envoyé 15 000 soldats et des navires pour mener ses propres opérations «anti-narcotiques» en mer et à terre.
Quelques jours plus tard, les Américains ont renforcé encore leur présence avec un porte-avions, le USS Gerald R. Ford, qui a quitté la Méditerranée pour rejoindre les Caraïbes et qui devrait arriver les jours prochains. D’après The Washington Post, il s’agit du plus grand déploiement naval dans la région depuis des décennies.
En parallèle, le Pentagone a fait voler des bombardiers le long des côtes vénézuéliennes et déployé des avions de combat F-35 à Porto Rico. Ces mouvements dépassent largement les besoins d’une simple opération antidrogue. Le président Donald Trump a reconnu vouloir faire pression sur Nicolas Maduro, tout en affirmant ne pas envisager de frappes directes à l’intérieur du pays.
Derrière le prétexte antidrogue: Les vraies raisons américaines
Officiellement, Washington prétend vouloir lutter contre le trafic de cocaïne, mais plusieurs analystes estiment que les motivations sont politiques. Les États-Unis accusent depuis longtemps le gouvernement de Nicolas Maduro et plusieurs hauts responsables d’être impliqués dans le trafic de drogue vers les États-Unis et l’Europe.
Selon le journaliste spécialiste dans les questions latines Ali Farhat, le rassemblement militaire américain a un objectif politique très important. Quand Trump dit que les jours de Maduro sont comptés, que le sénateur Lindsey Graham affirme que les États-Unis cherchent à renverser le régime, et que le secrétaire d’État Marco Rubio, qui nourrit depuis de nombreuses années une grande hostilité envers le régime vénézuélien, se prononce de la sorte, ils évoquent tous un changement politique majeur au Venezuela. Le rassemblement militaire vise à encercler le Venezuela, à attiser la discorde intérieure en incitant l’opposition et à tenter d’intimider les généraux.
En effet, selon les observateurs, cette offensive militaire s’inscrit surtout dans une stratégie de pression visant à affaiblir le régime de Maduro et à favoriser un changement de pouvoir. L’objectif serait de démoraliser l’armée vénézuélienne et d’accroître les divisions internes.
Selon Farhat, les Etats Unis tentent de changer l’identité politique de l’Amérique latine : plusieurs pays comme le Brésil, le Venezuela, le Chili, la Colombie, le Mexique, la Bolivie ont commencé à adopter des positions politiques différentes et entretiennent des relations étroites avec les rivaux historiques des États-Unis. Durant la guerre à Gaza, des dirigeants latino-américains ont clairement dénoncé le massacre à Gaza, mettant en lumière un fort contraste politique entre les États-Unis et leurs voisins, que Washington considère comme son «arrière-cour». Les responsables américains continuent d’affirmer la doctrine Monroe, répétant que l’Amérique est aux Américains et qu’elle a le droit de contrôler son arrière-cour.
Depuis Hugo Chavez, puis Maduro, le Venezuela est devenu un symbole de la gauche radicale en Amérique latine et un allié proche de la Russie, de la Chine et de l’Iran, des pays considérés comme rivaux par Washington. Pour les États-Unis, Caracas est donc un point d’influence hostile dans leur «arrière-cour» stratégique.
Le poids du pétrole et des alliances
Le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole au monde. Mais en échange de prêts et d’investissements, le régime Maduro a donné une partie du contrôle de ces ressources à la Russie et à la Chine.
Un changement de régime à Caracas permettrait aux États-Unis de récupérer l’accès à ce pétrole et de bloquer l’influence russe et chinoise dans la région. Farhat assure qu’un des objectifs du déploiement américain est d’éloigner la présence et l’influence sino-russe, qui ont de larges investissements au Venezuela et en Amérique latine ; l’administration américaine estime donc que le moment est opportun pour provoquer ce grand changement en Amérique latine en passant par la porte vénézuélienne.
Pour Washington, le pétrole vénézuélien représente donc un enjeu stratégique majeur, mais aussi une opportunité économique : un Venezuela stable et allié serait un partenaire énergétique fiable, contrairement à d’autres régions plus instables.
La riposte du Venezuela : résistance et alliances
Face à la montée des tensions, Nicolas Maduro a annoncé la mobilisation de millions de membres de la Milice bolivarienne, une force citoyenne censée défendre la patrie.
Il a aussi parlé d’un «état d’alerte maximale» face à la menace américaine et a renforcé les défenses militaires sur les côtes et aux frontières. Maduro a également appelé à l’aide ses alliés, la Russie, la Chine et l’Iran, pour l’aider à protéger le pays face à une agression américaine. Néanmoins, si le Venezuela reste seul dans cette guerre, tous ses moyens seront faibles face aux États-Unis qui peuvent tirer parti de l’opposition intérieure qui les soutient indique Farhat, ajoutant que le combat au Venezuela ne se limitera peut-être pas au cadre militaire, il pourrait s’y ajouter l’implication d’un certain nombre d’opposants visant à affaiblir l’intérieur du pays.
Les réactions internationales : Moscou, Pékin et Téhéran aux côtés de Caracas
La Russie a fermement dénoncé la campagne militaire américaine, accusant Washington d’utiliser «une force excessive» et de violer le droit international.
Partenaire militaire du Venezuela depuis plus de vingt ans, Moscou continue de lui fournir du matériel et de l’assistance technique. En octobre 2025, alors que la tension montait, Maduro a demandé l’aide directe de Vladimir Poutine. Selon des documents divulgués, il a sollicité la réparation d’avions de chasse, de radars et la livraison de nouveaux missiles russes.
Les deux pays ont ensuite signé un nouveau partenariat stratégique, qui prévoit une coopération militaire et énergétique renforcée.
La Chine soutient surtout le Venezuela sur le plan économique, mais aussi militairement, de manière plus discrète. Pékin n’envoie pas de troupes, mais fournit des technologies de défense, du matériel et des fonds. Maduro a même adressé une lettre personnelle à Xi Jinping, demandant davantage de coopération militaire pour contrer la pression américaine. Jusqu’à présent, la Chine aide surtout à former les forces vénézuéliennes et à entretenir les équipements déjà livrés.
Elle a par le passé vendu au Venezuela des radars, de l’artillerie, du matériel anti-émeute et même aidé au lancement d’un satellite, selon le Center for Maritime Strategy.
L’Iran, pour sa part, est aujourd’hui un partenaire clé du Venezuela, notamment depuis que les deux pays sont sous sanctions américaines. Téhéran aurait aidé à la production locale de drones et à l’amélioration du système de défense aérienne vénézuélien. Sur le plan économique, l’Iran envoie du carburant et des pièces pour les raffineries, contournant les sanctions américaines. Ce soutien permet au Venezuela de faire face à ses pénuries d’essence et de maintenir son économie à flot. Les deux pays ont signé en 2022 un accord de coopération de 20 ans, couvrant notamment la défense, la cybersécurité et le renseignement.
Un bras de fer à haut risque
Il est clair que cette montée de tension militaire dans les Caraïbes n’est plus liée à la lutte contre la drogue. Elle s’inscrit désormais dans une bataille politique et géopolitique plus large entre les États-Unis et le bloc formé par la Russie, la Chine et l’Iran. Le Venezuela, soutenu par ces puissances, apparaît aujourd’hui comme un symbole de résistance face à l’influence américaine. Mais une guerre à grande échelle contre ce pays pourrait entraîner des répercussions plus large sur le plan régionale et même international.
Comments