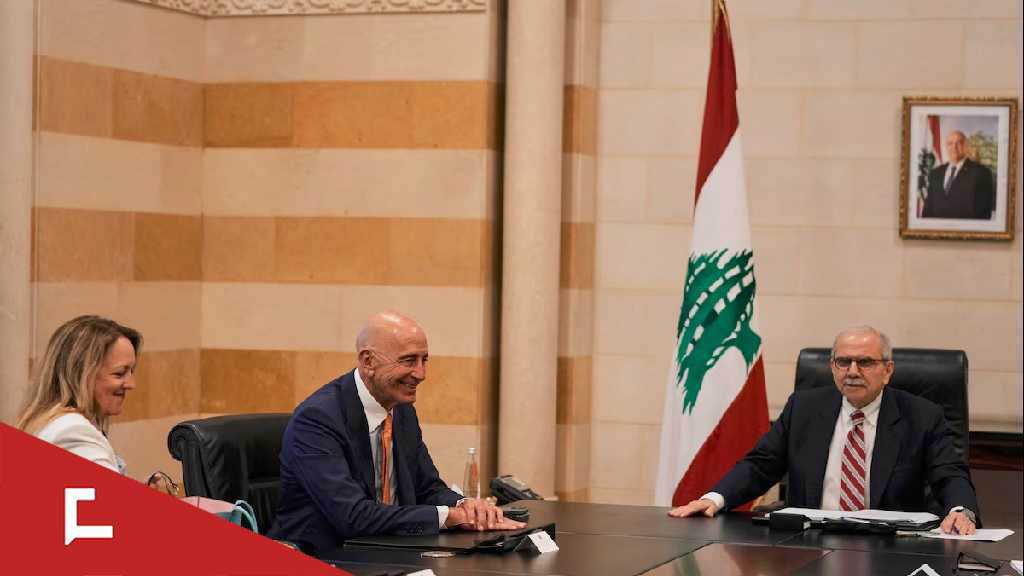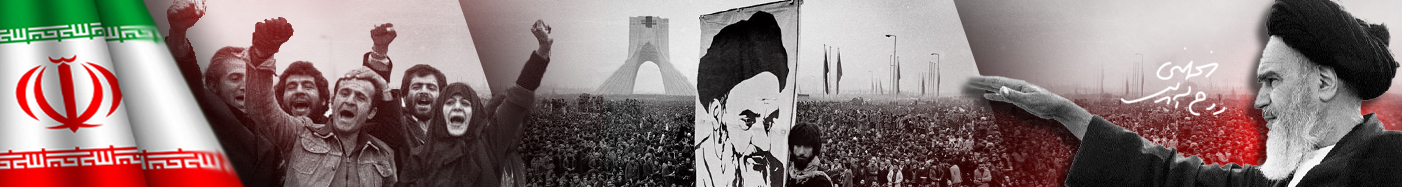La guerre contre l’Iran: Quand la supériorité militaire ne garantit pas la victoire

Par Assia Husseini
«La guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens», comme l'a formulé le théoricien militaire prussien Carl von Clausewitz. Cette maxime souligne que les États n’entrent pas en guerre au hasard : ils visent des objectifs politiques précis. Dès lors, sans identifier ces objectifs, il est impossible d’évaluer si une guerre a été un succès ou un échec. Définir les buts de guerre devient donc une condition essentielle pour juger rationnellement l’issue d’un conflit.
C’est dans cette logique que le «Premier ministre israélien» Benjamin Netanyahou a déclaré les objectifs de la guerre contre la République islamique d’Iran, quelques heures à peine après le début de l’attaque contre Téhéran le 13 juin. Dans un discours de sept minutes prononcé en anglais, Netanyahou a fixé trois objectifs majeurs : renverser le régime iranien, détruire son programme nucléaire et anéantir son arsenal balistique.
Mais Netanyahou a-t-il réellement gagné cette guerre, comme il l’a proclamé peu après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu ?
Un échec «israélien» sur le plan stratégique ?
Selon le général Hicham Jaber, expert stratégique et militaire, l’Iran a su relever le défi dès les premières 24 heures de l’assaut militaire, en remplaçant rapidement les chefs militaires tombés en martyr et en lançant une riposte massive par missiles contre les territoires palestiniens occupés. Les États-Unis avaient pourtant fourni à «Israël» des batteries de missiles de défense THAAD – parmi les plus sophistiquées au monde – qui n’ont cependant pas réussi à intercepter tous les missiles balistiques iraniens. Pour Jaber, cela constitue une preuve que l’entité sioniste a perdu sa force de dissuasion et qu’elle apparaît désormais comme un État fragile, incapable d’assurer sa propre protection. Il estime qu’une guerre d’usure avec l’Iran serait catastrophique pour les colons «israéliens», dont un nombre croissant aurait commencé à fuir l’entité via les pays arabes frontaliers ou par des voies maritimes.
M. Jaber ajoute que, grâce à sa vaste superficie et à son armée bien équipée, l’Iran aurait été capable de poursuivre cette guerre et d’en supporter les dégâts, contrairement à «Israël», qui serait dans l’incapacité de survivre à un tel affrontement, même avec l’appui des États-Unis.
Qu’en est-il du programme nucléaire iranien ?
Concernant le programme nucléaire, et malgré les déclarations du président américain Donald Trump affirmant avoir «anéanti» les capacités nucléaires de l’Iran en bombardant les trois principaux sites de Natanz, Fordo et Ispahan, l’évaluation des dégâts reste incertaine. La chaîne CNN a révélé qu’un rapport des renseignements militaires américains suggérait que ces frappes n’auraient pas détruit les installations nucléaires, mais seulement retardé le programme iranien de quelques mois. Mohamed Eslami, directeur de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique, a quant à lui déclaré que l’Iran reprendrait les activités d’enrichissement «au moment opportun».
Un régime affaibli, mais toujours debout
Quant à l’objectif de renversement du régime iranien, il s’est avéré illusoire. Le pouvoir en place semble bien plus solide que ce que prévoyaient les services de renseignement «israéliens». Certes, le martyre de plusieurs hauts responsables a porté un coup dur à la structure du régime, mais cela n’a en aucun cas provoqué son effondrement. Au contraire, la population iranienne est descendue massivement dans les rues des grandes villes, exprimant son soutien aux forces armées, aux Gardiens de la révolution, et au Leader de la Révolution islamique d’Iran, l’imam sayyed Ali Khamenei.
Un conflit asymétrique par nature
L’analyse du conflit entre la République islamique d’Iran et l’entité sioniste révèle qu’il s’agit d’un affrontement asymétrique, où deux acteurs aux capacités militaires et stratégiques très différentes s’opposent. Sur le plan militaire conventionnel, «Israël» bénéficie d’une supériorité évidente en matière de puissance aérienne, de capacités navales, de technologie de pointe et de renseignement, notamment grâce à une coopération étroite avec les agences des pays occidentaux alliés, ce qui lui permet de disposer d’un vaste «banc de cibles».
Cependant, dans cette dernière confrontation, l’Iran n’a fait appel à aucun de ses alliés régionaux. Elle a mené la bataille seule, tandis qu’«Israël» s’est appuyé sur un soutien politique et militaire étendu des États-Unis, de l’Europe, et des bases militaires américaines présentes dans les pays du Golfe, qui ont activement participé à la protection de son espace aérien.
La victoire dans la guerre asymétrique
Comme le soulignent de grands penseurs militaires tels que Mao Zedong, la victoire dans une guerre asymétrique ne se mesure pas à la supériorité militaire, mais à la capacité de l’acteur le plus faible à atteindre ses objectifs stratégiques, à éviter l’anéantissement, à saper la volonté de combattre de l’ennemi, et à modifier à son avantage le rapport coût-bénéfice du conflit.
D’un point de vue militaire, l’Iran a remporté une victoire en résistant à l’offensive «israélienne» et en infligeant des coups importants. Reste à savoir comment cette victoire se traduira sur le plan politique.
Comments